Note de Cbristine Tasin
L’article est clair. Bien que pas une fois le mot islam ne soit prononcé tout le monde comprend que ces femmes battues sont des victimes d’un mari ou compagnon musulman. On a les mêmes partout dans le monde. Néanmoins la pression du politiquement correct est telle que, 3 fois dans l’article (encadrés en bleu) ils réussissent à dire que, peut-être, il y aurait autant de femmes battues de souche canadienne que d’immigrantes, mais que les premières se tairaient, auraient des réseaux pour se mettre à l’abri.
Tant que le politiquement correct sera à l’oeuvre, non seulement les femmes, immigrantes ou de souche, ne seront pas à l’abri mais on continuera d’importer des gens violents, avec une culture primitive, misogyne et violente qui menace les nôtres.
Les immigrantes sont surreprésentées dans les maisons d’hébergement, au point qu’elles y forment une majorité dans la région de Montréal. Les acteurs de terrain constatent non seulement que le phénomène est en augmentation, mais aussi que les femmes ont des statuts de plus en plus fragiles.
Une dizaine d’immigrantes victimes de violence ont témoigné au Devoir dans les derniers mois. La plupart ont demandé d’être présentées sous des prénoms d’emprunt pour des raisons de sécurité dans cette enquête. C’est Caroline, venue avec un permis de travail lié à son conjoint étudiant. Ou Mélissa et Sofia, mariées dans leur pays d’origine à un homme déjà installé ici et dont le parrainage a été retiré une fois la violence dénoncée. C’est Ivonne Fuentes, parrainée par un Québécois en région.
Ce sont deux femmes à qui un conjoint avait promis un parrainage jamais déposé, et qui se sont retrouvées sans statut avec un nouveau-né. C’est une réfugiée mariée ici qui craint son ex-conjoint et l’exclusion de sa communauté d’attache. C’est Silvia, tombée enceinte alors qu’elle n’avait qu’un visa de touriste et qui a vécu deux ans et demi sans statut avec son autre petite fille. D’autres, aussi, déjà résidentes permanentes, mais convaincues que leur conjoint ou la police avaient le pouvoir de les expulser si elles portaient plainte, comme Lucienne.
Les trois associations de maisons d’hébergement pour victimes de violence conjugale du Québec sont sans équivoque : la proportion des femmes nées à l’extérieur du Canada hébergées dépasse nettement leur poids dans la population en général.
NOTRE BALADO
Réalisé par Le Devoir, le premier épisode du balado À double tour, qui donne la parole aux victimes citées dans cette enquête, peut être écouté en ligne.
Dans les 46 établissements membres du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, elles représentaient 69 % des femmes dans la région de Montréal et 51 % à Laval. Dans la région de la Capitale-Nationale, elles étaient 27 %, ce qui dépasse donc largement la proportion d’immigrants de 6,7 % dans la population générale.
La moyenne générale à l’échelle de la province était de 19 % l’an dernier au Regroupement, et de 26 % dans les maisons d’urgence de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF).
Quant à l’Alliance des maisons d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2), les immigrantes y ont représenté l’année dernière les trois quarts des femmes hébergées à Montréal et le tiers de celles hors métropole. La « deuxième étape » désigne l’accès à un appartement et à des services pour une durée plus longue après un logement d’urgence de quelques mois. En moyenne, dans leurs 18 maisons présentement en fonction sur tout le territoire, c’était près de la moitié des femmes hébergées qui étaient nées à l’extérieur du Canada.
Nous avons aussi parlé au cours des derniers mois à une trentaine d’autres personnes liées au milieu de la violence conjugale. Intervenantes en maison d’hébergement, travailleuses sociales, spécialistes de l’accueil des immigrants, policières, avocates et une infirmière : toutes ont dû s’adapter à cette nouvelle réalité, souvent avec des ressources insuffisantes, des programmes inadéquats et des lois qui ne la prennent pas en compte.
Plus précaires
Ce qui inquiète encore davantage les maisons d’hébergement est que les statuts précaires sont de plus en plus courants.
Demandeuse d’asile, étudiante étrangère, travailleuse, femme parrainée par son conjoint : environ une femme sur dix en hébergement n’a pas de statut permanent, selon les regroupements consultés et le dernier diagnostic de Statistique Canada. C’est plus de trois fois la proportion des femmes temporaires dans la population en général.
« La ligne est mince pour ces femmes-là de tomber sans statut », observe Katia Jean Louis, agente de liaison à la Maison pour femmes immigrantes de Québec.
Ces femmes détenant un visa temporaire font souvent passer le maintien de leur statut avant leur santé ou leur intégrité physique. Celle qui a demandé à se faire appeler Caroline* tenait par exemple avant tout à conserver son emploi, si difficilement trouvé : « Je restais tétanisée, je faisais de mon mieux pour protéger mon visage. Je ne voulais pas que cela se sache à mon travail », dit-elle après avoir décrit trois moments où son ex-mari lui a donné des coups.
« Je voulais pouvoir faire un permis de travail. […] C’était devenu invivable dans la maison, mais je suis restée quand même », raconte-t-elle, étant donné que son permis était lié à celui de son mari.
Temporaires ou permanentes, « le point commun de toutes les femmes immigrantes, c’est vraiment la peur. Car c’est ce qui est inculqué par la personne violente : “Tu vas être expulsée dans ton pays, tu ne peux rien faire, tu n’as pas de droit ici” », expose Mayranie Lacasse, coordonnatrice de l’Inter-Val 1175.
Les femmes qui nous ont raconté leur histoire n’ont pas toutes séjourné en maison d’hébergement après avoir quitté leur partenaire violent. Mais toutes l’ont dit et répété à leur manière : l’immigration les a rendues plus vulnérables à la violence conjugale. Même pour Lucienne, arrivée du Cameroun au Québec depuis 2011, dont l’ex-mari lui disait qu’il avait le pouvoir de l’expulser du pays, puisqu’il l’y « avait fait venir ».
Au-delà des préjugés
« Je peux vous dire que le processus d’immigration en soi, c’est stressant, indépendamment de la violence conjugale. Donc, une femme qui est dans ce processus-là se retrouve […] dans une situation de double vulnérabilité par rapport à la violence conjugale », observe notamment Mme Jean Louis.
Ce n’est pas à cause de leur personnalité ni de leur culture que ces femmes sont plus vulnérables, soulignent des chercheuses et des intervenantes. L’immigration et tout ce qui l’encadre ici au Canada créent des « contextes de vulnérabilité », explique la chercheuse Sastal Castro-Zavala, professeure de travail social à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).
Certains contextes « peuvent favoriser la domination, la prise de pouvoir et les oppressions, et donc rendre plus facilement vulnérable à cette violence-là », explique-t-elle. Elle donne l’exemple du parrainage, qui « crée des inégalités à l’intérieur d’un couple », notamment à cause d’une « dépendance » accrue et presque totale au conjoint qui contrôle les démarches d’immigration.
C’est ce qui est arrivé à Mélissa, une femme du Maghreb, qui raconte qu’elle ne savait pas comment prendre l’autobus même après plusieurs mois passés ici. « J’ai voyagé, j’ai étudié à l’université, j’avais mon côté indépendant. Mais en arrivant ici au Canada, un pays de droit avec un mari pareil, j’étais en prison », expose-t-elle.
« L’immigration, beaucoup font le mélange avec culture. On dit : “Ah ! les femmes immigrantes, [leur] culture est violente.” Il faut faire attention parce que beaucoup de femmes immigrantes se trouvent dans un contexte de vulnérabilité. Elles ne se séparent pas, [ce n’est pas] pour une question culturelle, mais pour une question structurelle » expose Mme Castro-Zavala.
Cet amalgame a la vie dure et il est parfois un « éléphant dans la pièce » : comment aborder le fait que les immigrantes sont surreprésentées dans les maisons d’hébergement sans alimenter les préjugés envers certaines cultures ?
Les femmes nées ici « ont peut-être d’autres réseaux que les maisons d’hébergement », dit Maud Pontel, coordonnatrice générale de l’Alliance MH2. Elles ont notamment plus souvent « des capacités financières pour, par exemple, déménager ou peut-être de la famille chez qui elles peuvent aller habiter ».
Ne plus se taire
Il ne faut pas non plus ignorer le poids et l’influence de la famille restée au pays : « Il arrive qu’une femme vienne nous voir et, pendant qu’elle nous parle, son téléphone ne fait que sonner, la famille l’appelle sans arrêt », raconte Rose Ndjel, directrice d’Afrique au féminin. Ce centre de femmes du quartier Parc-Extension reçoit trois ou quatre femmes par semaine, évalue-t-elle, qui sont victimes de violence, que ce soit pour leurs besoins alimentaires, d’intervention ou de référence.
« Ça arrive que, quand la femme fait valoir ses droits dans la maison, elle devient désobéissante aux yeux du mari », constate-t-elle. Il est arrivé que des hommes « viennent jeter les valises des femmes devant le centre », rapporte Mme Ndjel. Mais pour elle, ces femmes entament leur propre prise de parole, après des années du mouvement #MoiAussi. Dans une marche organisée à la fin octobre 2023, elle les y encourage : « Si vous voulez parler fort, allez-y ! »
Devant les besoins de plus en plus criants, l’organisme communautaire a fait des demandes pour créer La Maison Augustine, une maison d’hébergement spécialisée dans les contextes d’immigration.
Une ressource pionnière de ce type, Le Bouclier d’Athéna, constate que, malgré certaines améliorations, les besoins de ces femmes tardent à être pris en charge : « Nous avons vu beaucoup de femmes qui, malheureusement, ne peuvent pas être traitées dans le réseau des services sociaux existants ; 80 % de tous nos cas nous viennent du réseau de services existants. Ce sont les autres maisons d’hébergement, les CAVAC, la DPJ, les hôpitaux, etc. », dit Melpa Kamateros, la directrice générale de l’organisation.
Pour celle qui y travaille depuis plus de 30 ans, « il n’y a pas le même filet de sécurité », surtout pour celles qui ne parlent pas le français ni l’anglais. Elle reste tout de même optimiste, souvent encore étonnée de la force de ces femmes : « Dès qu’elles prennent les renseignements, elles sont prêtes à partir. Elles sont prêtes à prendre leur vie en main. »
Demain : même permanentes, des femmes fragilisées par l’immigration racontent leur histoire
UN PORTRAIT CLAIR, MAIS PARTIEL
Le nombre d’immigrants a bien sûr augmenté dans les dernières années au Québec. Mais la proportion des immigrantes en maisons d’hébergement s’est accrue plus fortement. Au Regroupement, les immigrantes sont passées de 13 % en 2019-2020 à 19 % en 2022-2023.
Cette réalité est observée en dehors de la métropole, dont à Gatineau. « Dans les dernières années, c’est très, très, très, très fréquent que nous ayons des femmes sans statut », confirme notamment Denise Bugere, coordonnatrice à l’intervention à la Maison Unies-vers-femmes.
En dehors des plus grands centres urbains, les ressources voient également le phénomène poindre, à L’Islet et à Saint-Georges de Beauce par exemple. La maison d’hébergement La débrouille, de Rimouski, souligne notamment avoir reçu deux personnes sans statut dans les dernières années.
Toutes ces données donnent un portrait clair, mais cela ne signifie pas automatiquement que les immigrantes sont plus victimes que les femmes nées ici, précise la chercheuse Sastal Castro-Zavala.
Cet état des lieux comporte d’autres zones d’ombre. Ni les services de police, ni le bureau du coroner, ni le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), ni l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) ne compilent de statistiques spécifiques concernant le statut migratoire des victimes.
Certaines analyses de Statistique Canada avancent qu’une plus faible proportion d’immigrants subissent de la violence conjugale, par rapport aux non-immigrants.
Ce type d’enquête se fait cependant souvent encore au téléphone, souligne par ailleurs la professeure de l’UQAR. Des femmes qui ne parlent ni français ni anglais sont donc susceptibles tout simplement de ne pas y répondre.
Il pourrait ainsi y avoir, au contraire, une sous-estimation des victimes immigrantes. Une étude de 2005, qui n’a pas été mise à jour, a avancé qu’elles étaient surreprésentées dans les cas traités à la Cour municipale de Montréal. D’où ces « contradictions », ce qui n’entache en rien le fait qu’elles soient plus vulnérables, selon Mme Castro-Zavala.
« Il y a beaucoup de femmes immigrantes ou à statut précaire qui ne vont pas nécessairement dans les ressources. D’une part, parce qu’elles ne les connaissent pas et, d’autre part, parce que reconnaître qu’on est victimes de violences conjugales, c’est quelque chose d’extrêmement difficile pour elles », explique Maud Pontel, de l’Alliance MH2. La barrière de la langue est notamment évoquée.
AU BOUT DU FIL
Le service de consultation juridique Rebâtir découle directement de cette démarche et reçoit aussi des appels d’immigrantes. Un total de 2785 consultations en rapport avec le droit de l’immigration avait été réalisées en date du 3 novembre dernier. Deux ans après l’instauration de ce service, elles n’étaient pas majoritaires sur un total dépassant les 40 000 consultations.
Ce qui n’empêche pas le statut d’immigration d’être « extrêmement anxiogène » pour les personnes qui utilisent ce service de 4 heures de consultation gratuite, explique Me Marie-Andrée Fogg, avocate à Rebâtir. C’est l’une des questions à régler « le plus rapidement possible », dit-elle, il n’est donc pas rare que quatre heures de consultation soient ajoutées dans ces cas complexes.
À la ligne SOS Violence conjugale, seuls 1000 appels sur 50 000 en 2022 ont été réalisés dans une autre langue. Il est pourtant possible de s’adresser à l’intervenante qui répond pour demander de l’aide dans leur langue, explique Claudine Thibodeau, travailleuse sociale et responsable de la formation et du soutien clinique.
Besoin d’aide ?
Si vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez appeler la ligne d’urgence de SOS violence conjugale au 1 800 363-9010.
Contactez À coeur d’homme (par téléphone : 418 660-7799, sans frais 1 877 660-7799), ou rendez-vous à quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes pour contacter des organismes venant en aide aux hommesen difficulté.
828 total views, 1 views today

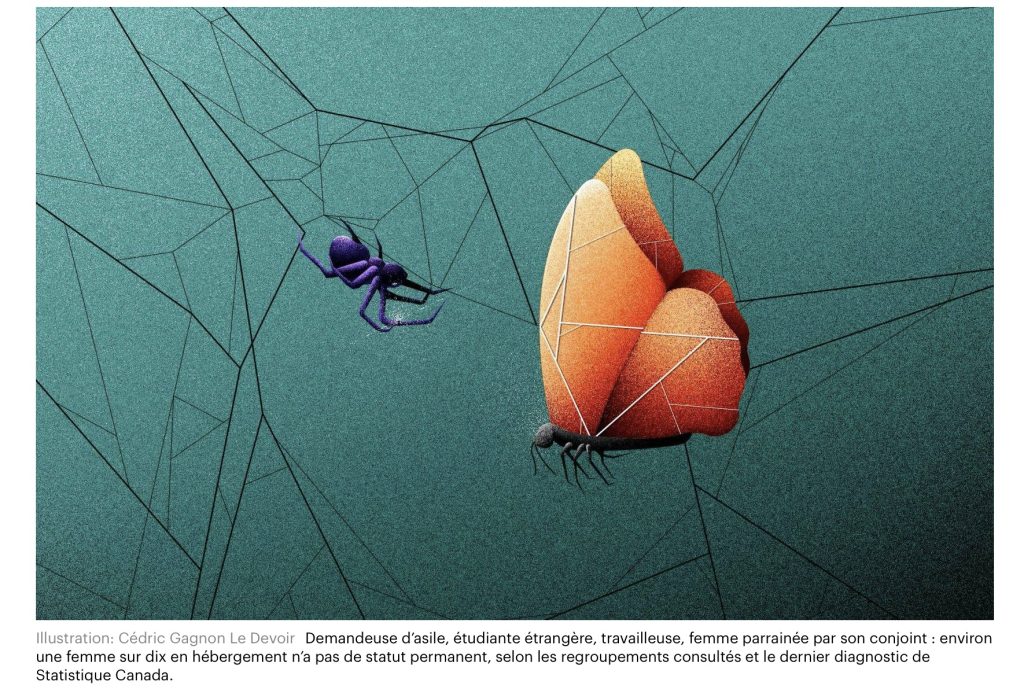

Tout ce que je remarque , c’est qu’ils s’installent partout, introduisant leur arriérisme et leur violence.
Invasion soutenue par Trudeau et ses semblables.
**Aux chiottes les socialistes et assimilés !
Sauvons les : renvoyons les chez elles !!! d’urgence !
Donc les violences conjugales c est la faute des lois canadiennes ! et pas d abord la culture musulmane qui donne tout pouvoir aux hommes not par la violence ou le « meurtre » et fait vivre les femmes dans la peur ( pourtant bien évoquée dans le texte officiel) Et au Canada depuis plusieurs années et elles ne parlent toujours pas correctement anglais ou français ? enfermées, sorties autorisées ?
A acceuillir toujours plus de migrants muzz, les canadiens sont tres mal partis…