Sommaire
Journal de la Société des Africanistes, 1937, tome 7, fascicule 1
par Denise Paulme
Étude sur une coutume Somalie : les femmes cousues, pages 15-32
par Annie de Villeneuve
Les femmes d’in Çalah, mangeuses de chats à l’occasion de la fête Es Sabaa, pages 33-35
par Michel Lesourd
Sur la répartition des groupes sanguins chez les indigènes de l’Afrique occidentale française, pages 37-40
par P. Rode
Coutumes des Imraguen (Côtes de Mauritanie, A. O. F.), pages 41-51
par Lieutenant Lotte.
Pierres et poteries sacrées du Mandara, Cameroun Nord (Mission Sahara-Cameroun), pages 53-68
par Paul-Henry de Lauwe
Blasons totémiques des Dogon, pages 69-78
par Marcel Griaule
La tache pigmentaire congénitale à Madagascar et aux Comores, pages 79-92
par Pierre Champion
Les plantes magiques cultivées par les Noirs d’Afrique et leur origine, pages 93-105
par Aug. Chevalier
Une carte des gravures rupestres et des peintures à l’ocre de l’Afrique du Nord, pages 107-123
par Robert Perret
Les récits des voyageurs ont noté depuis longtemps l’existence d’une coutume cruelle appliquée aux femmes des tribus somalies et qui comporte, outre l’excision, si fréquente déjà dans tout le continent noir, l’infîbulation, pratique plus rare, sinon entièrement particulière à cette population.
Ces femmes, les femmes de Djibouti surtout, sont nommées dans ces récits femmes cousues, dénomination tout à fait impropre et qui laisse croître souvent, dans l’esprit de ceux qui n’ont pas approfondi la chose, une grossière erreur.
Il ne s’agit pas en effet, comme l’imagination peut le croire, sur la foi de ce terme inexact, sur la foi aussi de descriptions fantaisistes, d’une couture pratiquée sur le sexe de la femme, à l’aide d’aiguille et de fil ou d’instruments analogues et destinée à la protéger, dans les cas où le viol est à craindre, contre l’audace d’un ravisseur. Il ne s’agit surtout pas d’une coutume occasionnelle, intermittente, comparable à celle des ceintures de chasteté de notre moyen âge, mais d’une pratique aux fins plus mystérieuses qu’on ne l’imagine, d’une fermeture naturelle par voie de cicatrisation, d’une véritable mutilation sexuelle de la femme, qui durera de son âge le plus tendre jusqu’à sa mort et qui affecte toutes les femmes somalies sans exception, fussent-elles même destinées à la prostitution. Appliquée rigoureusement encore de nos jours, elle persiste non seulement dans le grand désert somali où la sauvagerie a gardé tous ses droits, mais aussi dans les villes où l’indigène pourtant s’humanise, à Djibouti même, la plus grande et la plus civilisée d’entre elles, toujours aussi vivace, abritée sous le manteau bénévole de l’Islam.
De timides essais, d’ailleurs individuels, pour la faire disparaître n’ont abouti à rien. A l’inverse de ce qui se passe pour la coutume du meurtre obligatoire et de l’émasculation des victimes en faveur chez les hommes somalis, coutume qui tend à dégénérer au contact des civilisés, celle qui excise et infibule les femmes n’a subi tout au plus qu’une régression infime, semble-t-il. Telle qu’elle nous apparaît aujourd hui, telle fut-elle sans doute à peu près aux âges où elle naquit et que recouvre la nuit historique de ce peuple.
Cette façon de martyriser, pour ainsi dire, toute la vie de la femme Somalie peut se diviser en trois temps :
L’excision et l’infibulation faites simultanément sur la petite fille juste avant la puberté.
L’ouverture pratiquée par le mari au moment du mariage.
La seconde ouverture nécessitée par l’accouchement et que suit immédiatement une remise en état ou recicatrisation des parois fendues.
Excision et Infibulation
La double opération de l’excision et de l’infibulation se pratique sur les petites filles peu de temps avant la puberté, aux environs de six à huit ans. Elle est l’objet d’une cérémonie intime, se passant dans la case familiale, à laquelle la mère convie des parentes ou des voisines, exclusivement des femmes ou des jeunes filles, les hommes étant obligatoirement tenus à l’écart de ce spectacle. Si la mère n’opère pas elle-même, ce qui est le cas en général dans les agglomérations, elle prie la gedda1 de venir.
1. Gedda : en somali, veut dire grand-mère.
Celle-ci apportera son couteau et les épines ou la résine suivant les cas. La mère par contre fournit le tabouret du supplice, le gobelet d’eau fraîche, les nattes, les cordes de chiffons. Peu d’objets sont nécessaires à l’opération et les plus usuels rempliront leur rôle. Le tabouret de bois, taillé grossièrement, est celui qui sert dans toutes les cases à s’élever sur les angareb2, sur lequel, depuis des années, tous les pieds poussiéreux de la famille ont marqué leur empreinte.
2. Angareb : lit indigène, en général monté sur des pieds très hauts.
Le gobelet d’étain est celui qui demeure toujours à côté de la cruche, les nattes sont celles qui recouvrent le sol de terre de la case, les cordes, un assemblage de vieux chiffons noués entre eux et tordus pour la circonstance. La gedda a pris aux arbres de la brousse quelques-unes de leurs fameuses épines acérées et longues ou le mal-mal, gomme qu’elle a réduite en poudre. Son couteau est le couteau qui, chez elle, sert à tout faire : la cuisine, les travaux auxquels elle s’adonne, couteau à lame d’une dizaine de centimètres, à manche de bois très vulgaire qu’on achète couramment au bazar du village, à tranchant peu effilé, rouillé souvent, toujours sale.
Rien n’est prévu, on le voit, qui puisse donner à cette opération un semblant d’asepsie ou même d’adoucissement.
En ce qui concerne le moment, il ne semble pas qu’une date ou une époque quelconque de l’année soit choisie de préférence. L’ombre semble propice cependant, et à défaut de pouvoir la faire la nuit, faute parfois de lampes, on la fait à l’aube. Etant arrivée légèrement en retard au rendez-vous fixé, quand il me fut donné d’assister à cette opération, les femmes présentes firent remarquer qu’on avait à se presser, le soleil s’élevant déjà au-dessus de l’horizon.
L’opération ne s’adresse en général qu’à une petite fille à la fois, ou à deux soeurs, comme je la vis faire. On n’opère pas en commun un groupe d’enfants. La coutume est un rite qui s’exerce au sein de la famille, je dirai même plus : dans son secret, et qui n’intéresse en dehors de la mère, des soeurs de la patiente, que des parentes ou voisines affiliées par l’habitude à la case paternelle. Le père, qui n’assiste pas à l’opération, s’absente ou se retire sur le seuil au moment où l’on commence à disposer les objets et personne ne pourra entrer dans la case tant que durera la cérémonie. Appuyé sur son bâton, impassible aux cris qui lui parviendront, il semble garder la porte d’un mystère que les femmes accomplissent. A défaut du père, une femme ou une enfant remplira cet office, écartant les curieux qui pourraient tenter d’entrer. Et la porte par mesure de sécurité sera verrouillée.
Au moment venu, la jacasserie habituelle des femmes lorsqu’elles sont réunies, fait place à une activité soudaine. L’une d’elles déshabille la petite fille, la mettant complètement nue, tandis que les autres disposent dans un coin choisi de la cour1, deux sièges l’un devant l’autre.
1. Les cases à Djibouti sont précédées d’une cour fermée de branchages.
Sur le premier, à hauteur normale, s’assoit une femme, les jambes écartées ; sur le second, le petit tabouret sale, est assise l’enfant, le torse renversé en arrière, la tête entre les genoux de la femme. Celle-ci de ses deux mains appuie sur la poitrine frêle. Quatre autres femmes tiennent les bras qui déjà se débattent, écartent les genoux pliés et les maintiennent dans une position qui découvre largement le sexe.
La gedda qui vient d’aiguiser son couteau, en vain d’ailleurs, sur le rebord du petit tabouret, s’accroupit à la turque devant l’enfant, à même le sol. Elle ne bougera pas de cette position tout le temps de l’opération, gênée parfois par les mouvements de douleur de la patiente, mais toujours impassible, attentionnée et lente en son travail cruel. Aucune nervosité n’animera ses mains, aucune émotion ne précipitera son ouvrage barbare. Il faut du temps, elle le sait et ne se pressera pas. D’un geste décidé, elle incise suivant une courbe, le capuchon du clitoris qu’elle détache soigneusement.
Fouillant ensuite dans cette plaie avec ses doigts et détachant les parties adhérentes, elle tire sur le clitoris jusqu’à ce qu’apparaisse la fourche ou racine de l’organe. Celui-ci est coupé le plus loin possible. La plaie présente alors la forme d’un trou béant, profond et dont le sang coule abondamment.
L’excision proprement dite étant terminée, la gedda marque un léger temps d’arrêt, durant lesquelles les femmes ont le droit de s’assurer que tout est bien enlevé, ce qu’elle ne manquent pas de faire, tirant sur la plaie, la palpant de leurs doigts sales et se tachant les mains de sang. La mère qui assiste à cette torture a plus qu’une autre naturellement le droit de le faire et de donner son avis. Sur un geste d’elle, la gedda reprend son travail.
L’infîbulation qu’elle va pratiquer maintenant consiste à mettre à vif le bord des grandes lèvres afin d’obtenir ensuite, par le rapprochement de ces deux plaies, une soudure qui fermera la vulve jusqu’à la moitié environ de l’orifice vaginal. Peut-être est-ce la partie la plus douloureuse de l’opération — ou bien l’enfant excédée de tant de mauvais traitements ajoute-t-elle par sa nervosité grandissante à la douleur. Elle a crié certes durant l’excision, mais les cris vont reprendre maintenant jusqu’au hurlement. Elle va se débattre furieusement aussi, au point que la gedda sans cesse gênée par ses mouvements convulsifs devra plusieurs fois retirer vivement son couteau pour ne pas la blesser ailleurs.
Des récits qu’on m’avait faits à l’avance, mais qui ne pouvaient être tout à fait exacts, n’étant fondés que sur la description que font les indigènes de cette cérémonie, laissaient supposer que l’opératrice se contentait de fendre, d’inciser légèrement de la pointe du couteau, les grandes lèvres. La réalité, plus cruelle encore, consiste non pas à fendre, mais à enlever, au long de chacune des lèvres, un morceau de chair d’une largeur d’un centimètre environ sur quelques millimètres d’épaisseur. Ce travail se fait patiemment en commençant par le haut. Dès la première incision, la gedda commence à tirer sur le lambeau de chair, le coupant par à coups ; un véritable écorchement, comme on en voit figuré sur le fameux tableau de Gérard David à Bruges1.
1. Écorchement du Juge prévaricateur.
En arrivant à la hauteur voulue un coup sec détache ce lambeau qui va rejoindre à terre le clitoris déjà excisé.
J’ai compté un quart d’heure à vingt minutes pour l’opération totale. Sur ce temps, plus de la moitié est employée pour l’ablation des lèvres. Là encore le travail étant terminé, chacune des femmes l’examine. Sur une observation de la mère au sujet d’une des enfants qui furent opérées sous mes yeux, la gedda, reprenant son couteau après coup, fignola l’ouvrage.
L’enfant n’a pas cessé de hurler. Les cris sont entrecoupés des mots somalis : Rhalaç ! Ikafi !1.
1. Rhalaç : finis; Ikafi : assez.
Elle crie aussi : Allah! Allah! Elle n’appelle cependant pas sa mère, la sait probablement invulnérable à toute tendresse maternelle. Quand on la relève après avoir jeté sur son sexe tout sanglant un gobelet d’eau froide, elle trébuche un peu, se tient le ventre à deux mains et sanglote de toutes ses forces, la tête enfouie dans la jupe de la première femme qu’elle rencontre. Mais la pitié n’habite pas le coeur des femmes somalies et une natte ayant été jetée à terre, on l’y couche brutalement. Le nouvel écartement des jambes qu’on doit obtenir pour terminer l’infibulation lui arrache de nouveaux cris. La gedda, qui a retiré de son sein la poudre de mal-mal enveloppée d’un morceau de journal, en étend avec ses doigts une bonne épaisseur sur toute la plaie. Cette poudre d’un jaune gris est une résine tirée du kars ou kouran, arbre de la brousse. Mes recherches à ce point de vue me font supposer que ce produit n’est autre que la myrrhe2.
2. mal-mal en somali, mour ou nour en arabe yémenite. Cette résine est très employée en médecine indigène. On lui attribue, une propriété cicatrisante, des vertus hémostatiques. On l’emploie sous forme de liquide pour les enfants atteints de convulsions.
Cette soudure à l’aide du mal-mal est en faveur à Dijbouti. Dans la brousse, on emploie souvent, pour maintenir l’appareil en place, les épines d’un acacia nain qui, passées à travers les chairs, servent de sutures. Mais cet amarrage, qu’il soit fait d’une manière ou d’une autre, ne suffirait pas à produire une cicatrisation parfaite. Aussi ligote-t-on les jeunes patientes à l’aide de cordes, de la hanche aux genoux et les laisse-t-on, dans cette position, une quinzaine de jours. Elles passeront les premiers jours étendues sur leurs nattes, recouvertes d’un morceau de cotonnade dont on a soin de les couvrir entièrement, même la tête. Dès le troisième jour, quelquefois le second, elles peuvent se tenir debout, appuyées sur un bâton, mais leurs pas sont plutôt un glissement sur le sol que des pas proprement dits. Un obstacle, un seuil de quelques centimètres les arrêtent. Elles sont cependant gaies dès ce moment. La douleur semble oubliée et une gêne seule est le résultat de la torture de la veille.
Au bout de dix à quinze jours, la cicatrisation est en général obtenue. On détache les liens, on enlève les épines, s’il y a lieu, et l’enfant est libre de courir à nouveau. Son sexe présente alors l’aspect qu’il gardera jusqu’au mariage : à la place de la vulve, la recouvrant, un véritable mur de chair, une surface ininterrompue, relie les cuisses du pubis : l’anus, ne laissant à la hauteur du vagin qu’un orifice minuscule du calibre d’un doigt au maximum, souvent plus petit, par où doivent s’écouler à la fois l’urine et les menstrues. La cicatrice visible encore quelques mois disparaît en général tout à fait, effaçant jusqu’au dernier vestige de la barbare opération.
Le Mariage
La jeune fille Somalie se marie en général très jeune. Dès l’apparition de ses premières règles, la mère, en substituant à la coiffure enfantine de sa fille1, la coiffure à petites nattes graissées de la jeune fille, avertit par ce geste à la fois le père et le voisinage que sa fille est nubile.
1. Le crâne rasé ne laissant qu’une couronne autour du front et une touffe sur le dessus de la tête.
Si elle est jolie, un prétendant ne manquera pas de se présenter assez vite. Sinon, elle attendra, mais guère au delà de vingt ans. L’âge habituel du mariage est aux environs de douze à quinze ans. Remarquée par un homme, des pourparlers s’engagent entre les familles. Le père seul dispose de sa fille et la vend à sa guise. Il en reçoit le prix en argent, en chameaux, en moutons, suivant son désir. Le marché conclu, la mère reçoit aussi un petit cadeau du fiancé et la jeune fille un trousseau2.
2. Trousseau qui ne coûte guère plus de 150 francs, alors que la fille peut valoir plusieurs milliers de francs.
Purement et simplement vendue, la jeune fille n’a pas de dot. Elle n’est qu’un capital humain échangé contre du bétail ou des espèces sonnantes. Aussi sera-t-elle toujours l’esclave du mari, et le lui fait-il sentir dès le jour de ses noces quand on l’a laissée chez lui. Auparavant, la mère ou la soeur du fiancé est allée s’assurer que la fille est vierge, c’est-à-dire bien fermée, l’intégrité de l’hymen semblant inconnue et la chose ne pouvant d’ailleurs se vérifier derrière le mur de chair qui la clôt.
Sur assurance des femmes de sa famille, l’homme entre en possession de la jeune fille. Une habitude, qui tend à se perdre à Djibouti mais qui persiste dans la brousse, veut que l’homme, dès l’arrivée de la femme dans sa demeure, administre à celle-ci un certain nombre de coups de courbache3.
3. Courbache : fouet fait d’une lanière en cuir d’hippopotame.
Ce mauvais traitement appliqué, l’opération de l’ouverture commence. Si viril que soit l’homme, l’obstacle pour ses forces est infranchissable. Pour pouvoir posséder sa femme, il lui faut s’armer d’un objet tranchant : poignard, morceau de verre ou silex. L’opération se fait de bas en haut, le fil de l’instrument employé étant enfoncé dans la minuscule ouverture de la vierge et remonté d’un coup brusque ou en plusieurs coups, de façon à pratiquer une ouverture suffisante, mais pas plus qu’il n’est nécessaire, pour les rapports sexuels. Cette opération souvent maladroitement faite est très douloureuse encore une fois, les femmes en redoutent l’effet, en gardent par la suite, presque toutes, un souvenir d’horreur.
Les rapports réitérés que le mari doit avoir avec sa femme durant les sept jours qui suivent le mariage, empêchent cette nouvelle plaie de se souder à nouveau. La cicatrisation des bords de la nouvelle ouverture se fait assez rapidement et le sexe de la femme présente son nouvel aspect, à peine différent de celui de la jeune fille, si ce n’est que l’ouverture est un peu plus grande et plus arrondie.
La femme ne peut sortir, durant ces sept jours. Mais d’autres femmes peuvent venir la voir. Le mari, par contre, est libre. Le lendemain du mariage, il doit même obligatoirement se montrer au village armé de son poignard qu’il porte sur son épaule, signifiant par ce geste qu’il a ouvert sa femme et pris possession d’elle1.
1. A Djibouti où le port du poignard est interdit, celui-ci est remplacé par une canne ou le fourreau du poignard.
L’accouchement
L’ouverture pratiquée au mariage ne laisse pas, comme on pourrait le croire, la femme Somalie dorénavant tranquille. Elle est loin d’en avoir fini avec les affres du couteau. Les grossesses successives qu’elle aura se termineront toutes, en effet, par de nouvelles opérations. L’accouchement, déjà si douloureux chez la femme normale, va se compliquer pour ces malheureuses du fait que l’enfant ne pouvant franchir le mur de chair qui enferme encore, en partie, ses organes génitaux, il faudra de nouveau inciser et cette fois-ci assez largement pour permettre la naissance.
A cette occasion, la gedda est de nouveau appelée et de nouveau elle rapporte son vieux couteau. De nouveau aussi, l’homme est chassé de la case où il ne pourra revenir que quand tout sera fini. Les voisines sont réinvitées. Elles aideront la gedda et encourageront la patiente de leurs cris désordonnés, de leurs bavardages.
Par terre encore une fois s’assied ou s’agenouille la gedda. La femme est debout soutenue par des compagnes et se tenant agrippée à deux cordes suspendues au plafond. Parfois à l’imitation des femmes arabes, elle est assise sur le petit tabouret, dans la position qui fut celle de son excision. De toutes façons aucune douceur ne lui est accordée. Il n’est pas rare que des coups sur les reins, des pressions brutales sur le ventre, aident à un travail qui est parfois long. La femme Somalie n’accouche pas facilement. Elle est loin de pouvoir se vanter, comme les Juives de l’antiquité, d’accoucher sans douleur et sans aide. N’aurait-elle même aucune souffrance qu’une aide au moins lui est indispensable : celle de la gedda qui, au moment où la tête de l’enfant apparaît, passe la pointe de son couteau entre le crâne du nouveau né et la paroi que le mariage a laissée fermée.
Elle incise ce qui est nécessaire, recueille l’enfant, débarrasse la femme.
Pendant ce temps, les femmes présentes ont fait chauffer un peu d’eau de la cruche. Il convient que cette eau soit brûlante, presque à ebullition et telle quelle, à l’aide du gobelet, elle est versée sur la plaie, provoquant parfois des brûlures. Parfois aussi, accroupissant l’accouchée au-dessus d’un réchaud où brûle de l’encens, on l’expose aux fumées de ce produit qui passent pour avoir des vertus purifiantes1.
1. Ce produit est appelé onsi en somali.
Ces divers soins donnés, la femme est étendue, les bords de la nouvelle plaie sont rapprochés, les jambes à nouveau ligotées, comme au temps de son enfance, afin de tout remettre en état.
Aussi souvent sera-t-elle enceinte, aussi souvent, au moment de sa délivrance, devra-t-elle revoir le fameux couteau. Familiarisées par l’habitude avec ce sinistre instrument qui préside à toute leur sexualité, elles ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre qu’on pourrait faire autrement.
Excision, mariage, accouchement, ces trois phases de la vie des femmes somalies ne vont pas, comme on peut le penser, sans accidents physiques et psychiques.
Accidents physiques
En ce qui concerne les accidents physiques, l’infection, contrairement à ce qu’on pourrait déduire du manque total d’asepsie qui préside à ces opérations, n’est pas aussi fréquente qu’on l’a prétendu. Sans doute, la qualité très hémorragique de ces différentes interventions, l’étonnante vitalité de cette race que consume cependant depuis quelque temps une tuberculose envahissante, les conditions mêmes du pays, son soleil excessif, exterminateur de tant de germes, son atmosphère surchargée d’effluves marins, la propreté de la race à laquelle correspond la propreté des villages et, là où il n’y a pas de villages, la propreté du désert, sont-elles les raisons qui, suppléant à un manque d’hygiène, protègent jusqu’à un certain point, les femmes d’une infection. Cependant des cas existent où l’enfant meurt de son excision. La plaie infectée dégénère en ulcère tropical lent à se développer, mais entraînant la mort. Je n’ai pas entendu parler d’accidents dus au mariage, mais des fièvres puerpuérales enlèvent un assez grand nombre d’accouchées.
Plus fréquents sont les cas d’hématocolpos, dus à une fermeture trop absolue de la jeune fille, soit que la gedda ait été trop consciencieuse,soit qu’à la suite de l’opération une inflammation dénudant les bords de l’orifice conservé ait fermé aussi celui-ci1.
1. Un cas d’hématocolpos avec soudure du vagin sur la moitié de sa longueur a été observé au dispensaire de Djibouti.
Enfin, parmi les accidents où cette coutume conduit les malheureuses Somalies, il faut citer les cas assez fréquents dus à la maladresse des opératrices qui, au moment de l’accouchement, incisant l’obstacle de chair, coupent aussi la vessie. De nombreux cas de communication entre la vessie et le vagin ont été observés à l’hôpital de Djibouti2.
2. « La vessie est si largement ouverte qu’elle est mise à plat et constitue la paroi antérieure du vagin ». Communication du Dr Guirriec, médecin-chef de l’hôpital de Djibouti. (Le Siècle médical. 1er septembre 1935)
Disons enfin que presque toutes les femmes se plaignent d’éprouver des douleurs vives au moment de leurs règles, bien que ceci n’ait peut-être aucune relation avec l’opération qu’elles subissent.
Des observateurs (mais comment être renseigné exactement sur cette population nomade qui, même à Djibouti, est sans cesse errante) estiment à 20% environ le nombre de femmes et de petites filles victimes de cette coutume. Sans affirmer aucun chiffre, on peut dire cependant qu’il n’est pas rare d’entendre parler de femmes mortes en couches, de petites filles perdues par leur famille à l’âge de celles qu’on excise.
Accidents psychiques.
Les accidents psychiques que détermine cette cruelle invention sont en premier lieu une frigidité à peu près totale et une tristesse anormale.
Frigidité et tristesse qui peuvent évidemment provenir en partie des conditions misérables de ce peuple, dans un pays nettement inhumain, mais dont les caractères cependant, les formes très spéciales, trahissent aussi et surtout l’influence de la mutilation exercée.
Interroger une femme Somalie sur sa sexualité, sur le plaisir qu’elle peut éprouver à l’amour c’est, en général, se buter à un mur de timidité ou d’incompréhension infranchissable. Si la confiance arrive pourtant à s’établir, une moue de dégoût répond à votre interrogation, suivie, si on insiste, de paroles significatives : « Femmes somalies toujours souffrir, souffrir pour fermer3, souffrir pour ouvrir4, souffrir pour gagner-petit », cette dernière phrase exprimant à la fois l’acte de procréation et l’accouchement.
3. On ne dit pas coudre, mais fermer ou couper.
4. Casser en langage indigène.
Ainsi qu’en beaucoup d’autres endroits de l’Afrique, on ne dit pas, en effet, « avoir un enfant », mais « gagner petit », avec cette différence cependant que le gain, dans l’expression Somalie, ne semble pas être, comme pour d’autres races plus sensuelles, le fruit du hasard, d’une sorte de loterie, le résultat d’un jeu, mais, en tenant compte de l’intonation triste avec laquelle ces femmes prononcent ces mots, un gain acquis au prix d’un effort et récompensant une sorte de courage.
Un peu plus d’insistance amène d’autres paroles. La femme avoue sa peur de l’homme. Peur de ses coups d’abord dont aucune loi ne la protège et qu’il lui prodigue souvent, mais peur surtout de ses désirs de mâle, quand, ayant toute la journée traîné, au café indigène du village, à perdre le peu d’argent qu’il possède ou ayant gardé ses troupeaux dans les maigres pâturages de la brousse, il rentre le soir à la case et s’empare brutalement d’elle.
Infiniment prudes en ce qui concerne leurs actes amoureux, elles se taisent en général après cet aveu. On arrive cependant, par certaines, moins farouches, à comprendre que cette crainte est faite surtout de l’appréhension souvent justifiée d’avoir mal. Insuffisamment ouvertes, plus ou moins bien raccommodées après leur accouchement, souvent malades1 ou en butte aux maladresses d’un homme violent et sans tendresse, l’amour, indiquent-elles à mots discrets, les fait souffrir.
1. Presque toutes les femmes sont syphilitiques, porteuses de chancre, d’ulcères, de gommes.
La prostituée elle-même, chez qui, évidemment, on peut s’attendre à trouver du dégoût ou de la paresse dans ce qu’elle ne considère, à l’instar de ses soeurs européennes, que comme un métier lucratif, vous répond souvent non pas que l’amour lui indiffère ou l’excède, mais que l’amour lui fait mal.
Et le geste accompagné de répulsion sur le visage que celles-ci font quand on leur parle du soldat sénégalais qui hante leur quartier et se fait souvent renvoyer avec fracas, ce geste qui consiste à étreindre brusquement leur bras, signifiant par là la grosseur inacceptable de leur membre viril est significatif de leur douleur pendant le coït.
Certaines femmes cependant ne se plaignent pas, paraissent accepter l’homme, non seulement sans souffrances mais aussi sans peur. Moins maltraitées, sans doute, moins mutilées peut-être, elles semblent même désirer l’amour, mettant à l’approche de l’homme des herbes2 odorantes et excitantes, dit-on, dans leurs chevelures, se parant avec élégance.
2. Sorte de thym blanchâtre
Aucune sensualité réelle cependant ne les anime. Quelques questions, quelques réponses indiquent vite qu’elles ignorent toute volupté, que leurs coquetteries n’ont d’autre but que d’avoir un enfant, de conjurer le mauvais sort de la stérilité, la honte d’une répudiation, si elles sont « charmouttes »1, celui de gagner vite beaucoup d’argent.
1. Charmoutte en langue indigène : prostituée, fait au pluriel cheramit. Ce dernier terme n’est cependant presque jamais employé. On dit la charmoutte, les charmouttes.
Mieux servies que leurs soeurs par le sort, n’ayant à redouter ni coups de courbache, ni souffrances durant l’amour, ces dernières n’en sont pas moins frigides, pas moins inexpertes aussi, bornant leurs avances au mâle à quelques puériles questions de parures, ne sachant rien de ce qui peut exciter le désir, ne chantant jamais, ne riant même pas, dansant parfois, mais d’une danse insipide, d’un trémoussement maladroit, sans joie, sans conviction, sans cette ardeur qu’on rencontre souvent parmi les races noires et qui constitue une sorte d’aphrodisiaque, se livrant à l’amour, passives et inertes, et n’en recueillant personnellement, à quelques exceptions près, aucun plaisir.
La femme Somalie n’a en général pas de sensibilité sexuelle. Sans parler de la sensibilité clitoridienne, qui a disparu du fait d’une excision totale2, sa sensibilité vaginale elle-même semble très rudimentaire, en quelque sorte atrophiée et n’est l’apanage que d’un petit nombre, apanage d’ailleurs déconsidéré.
2. Certaines personnes m’ont affirmé une sensibilité clitoridienne, mais elles croyaient aussi à une excision tout à fait superficielle
Pour une raison difficile à éclaircir : inhibition lointaine de ces curieuses femmes, défense dont elles ont perdu le sens et qui n’est plus chez elles maintenant qu’une question d’usage, il est de bon ton, en effet, de ne pas parler d’amour, de ne pas se montrer nues, même au mari, de ne pas afficher un désir immodéré de l’homme. Une femme, comme on en trouve parfois chez les charmouttes, qui use de mots grossiers, de postures indécentes, pour attirer le client, qui, lorsqu’elle danse déshabillée, laisse la porte de sa case entrouverte, qui avoue se livrer volontiers à des hommes comme les Sénégalais, les Arabes ou les Ethiopiens connus pour leur sensualité, est méprisée du quartier. On la considère un peu comme folle, on dit d’elle qu’elle est possédée des démons, qu’une cérémonie d’exorcisme pourra seule les chasser de son corps, on l’injurie en paroles et par le geste traditionnel qui consiste, en rapprochant les deux premiers doigts des mains, à simuler un trou béant. Insulte grave entre toutes ; qui suspecte la femme visée d’avoir un orifice vaginal trop ouvert. Suprême mépris : un orifice petit étant un apanage envié, un signe de distinction certaine.
Disons enfin, car certains contradicteurs l’affirment, qu’aucune homosexualité ne m’est apparue chez elles, pas plus, semble-t-il, qu’aucune masturbation.
On ne peut appeler, en effet, homosexualité les tendresses qu’elles se font : se tenir par la taille, s’étendre pour la sieste l’une contre l’autre, s’éventer mutuellement, se faire de menus cadeaux ou se prêter leurs bijoux, tendresses de petites filles qu’elles sont restées malgré l’âge et qui ne vont pas au delà quoi qu’on en ait dit : chatteries dans lesquelles on ne peut voir tout au plus qu’un désir de douceur dans leurs vies souvent violentées et malheureuses, au maximum, un obscur et symbolique regret de la volupté dont elles ont été frustrées.
La tristesse de la race Somalie, autant que sa beauté, a toujours frappé les voyageurs. Hommes, femmes, jeunes gens ou vieillards — les enfants seuls étant indemnes de cette marque — , une perpétuelle grisaille semble peser sur leur être. Indifférents à tout, plus même que ne le comporte la loi fataliste de l’Islam qu’ils subissent, rien ne semble jamais leur faire plaisir, rien non plus n’obtient d’eux la moindre reconnaissance. On dirait qu’ayant attendu en vain je ne sais quelle formule de bonheur, ils y aient renoncé à jamais, épuisant leur vie en des rêves vagues, indéfinis comme le désert qu’ils habitent, subissant à l’excès la paresse des mélancoliques.
Mais cette tristesse, déjà si frappante chez l’homme, est plus entière encore chez la femme, trahissant dans son acuité même, une cause plus grave que celles qu’on invoque en général : climat excessif, pauvreté, nomadisme constant, esclavage ou santé défaillante.
Sans nier que toutes ces choses puissent contribuer, dans une large mesure, à l’affaissement moral de ces femmes, il faut accepter aussi, je crois, l’idée que leur mutilation sexuelle n’y est pas étrangère. Une certaine impuissance, je dirais même plus, une certaine répulsion à s’occuper de leurs familles, de leurs maris qu’elles n’aiment pas, de leurs enfants qu’elles n’aiment guère davantage, est caractéristique.
A côté des femmes arabes, soumises pourtant aux mêmes conditions de climat, de religion, d’esclavage, de pauvreté parfois, elles sont des mères médiocres, considérées même souvent comme indignes, sans que cela d’ailleurs leur fasse le moindre effet. Impassibles dans leur cruauté envers leurs filles, au moment de l’excision, n’ayant pas une défaillance dans leur froideur, elles ne sont guère plus tendres envers leurs garçons, les battant souvent, les renvoyant à la rue, à la mendicité s’ils ont faim, ne s’attendrissant pas s’ils sont malades ou blessés, ne les soignant pas. Un peu plus humaines avec les tout petits, elles n’ont cependant aucune tendresse réellement maternelle pour eux. Faire une caresse à un bébé somali en présence de sa mère n’amène pas un sourire de leur part, pas même un de ces orgueils que les femmes pourtant, même les plus primitives, éprouvent toujours pour l’enfant admiré.
On dirait que ce petit être issu de leur chair ne les intéresse pas, n’est pas à elles. « II est au père », disent-elles souvent en réponse à un étonnement de les voir ainsi, marquant par là l’affreuse réserve de leurs sentiments affectifs quelles semblent, avec leur sexualité, avoir condamnés à jamais.
Inaptes aux soins ménagers, ne connaissant des travaux de la femme que les plus rudimentaires : puiser de l’eau, laver le linge, acheter au marché quelques denrées qu’elles grignoteront au long du jour sans même les cuisiner, ignorant toute économie, ne sachant ni filer, ni tisser, ni broder, se contentant pour occuper leurs interminables loisirs de faire parfois quelques grossières nattes en fibres de palmier pour combler les trous de leurs huttes misérables, elles ne s’animent que pour se disputer entre elles, s’injuriant avec des flots de paroles, de cris, de coups, exutoires de leur éternelle mélancolie.
Chez certaines cependant plus civilisées : trieuses de café1, femmes de boys2, charmouttes, un souci de travail ménager et de maternité s’aperçoit, corollaire sans doute d’une vie plus douce.
1. Djibouti emploie un assez grand nombre de femmes aux besoins du commerce du café.
2. Boy : dénomination du Somali domestique dans les maisons européennes.
Qu’on les voie dans leurs cases, qu’on les rencontre au dispensaire des femmes3 où elles consentent à venir et à amener leurs enfants, au marché où elles pérorent, on est frappé pourtant de constater que, plus vives peut-être que les autres, ayant un intérieur moins misérable, plus enjolivé, elles n’en conservent pas moins une marque indélébile de tristesse, souriant parfois, mais ne riant jamais franchement.
3. Dispensaire Chapon-Baissac à Djibouti.
Durant les grandes fêtes musulmanes : la fin du Ramadan, celle d’Ain id Kébir4 en particulier, où le second jour cependant est réservé à leur distraction, on les voit peu dans la rue, ne se mêlant que timidement aux jeux établis sur la place du village, préférant s’enfermer dans leurs cases, où des parlotes interminables sur des riens leur suffisent.
4. Aïn id Kébir ou Fête du mouton.
Si l’amour maternel chez ces dernières a crû au point de les porter à se soucier de leur progéniture, la soigner, la vêtir, il n’arrive quand même pas à les émouvoir bien fortement. On cite comme un cas rare à Djibouti une femme ayant pleuré plusieurs heures son enfant mort. Toujours aussi cruelles en ce qui concerne leurs coutumes sexuelles et forcenées d’ailleurs comme toute les femmes somalies à la perpétuer, l’homme n’ayant contrairement à ce qu’on pense d’habitude aucune influence ni autorité en cette matière1, et les femmes accomplissant seules et de plein gré ces rites barbares ; elles ne s’y dérobent et n’y dérobent pas davantage leurs filles, cachant sous la pérennité de cette mutilation je ne sais quel secret qui pourtant les endeuille.
1. Beaucoup d’hommes, à qui on reproche d’admettre cette coutume chez eux, conviennent en effet qu’elle est cruelle et inutile, mais déclarent ne pouvoir rien y changer, affirmant qu’une défense de leur part ne serait pas observée par les femmes.
Il y aurait beaucoup d’autres observations à faire concernant les effets psychiques de cette coutume sur les femmes somalies. Je n’ai voulu m’arrèter qu’aux principaux : leur frigidité et leur tristesse, leur impuissance affective, leur goût morbide de la claustration sexuelle qui m’ont semblé les plus évidents et les plus contrôlables. Disons cependant, à titre d’indication de leur caractère très particulier, qu’elles ont un goût tout à fait immodéré pour les parures, les bijoux en particulier, manifestant à ce sujet d’exceptionnelles passions d’envie et de jalousie, s’endettant considérablement pour y satisfaire ; un goût non moins vif pour les charmes, les aphrodisiaques, les sortilèges. Elles craignent aussi toutes sortes de démons et excellent aux séances de sorcellerie destinées à les chasser. L’état cataleptique, durant ces cérémonies, est fréquent chez elles. Plus rare, presqu’inconnue est la folie.
Des causes de l’infibulation
D’où vient cette coutume à la fois si cruelle et si bizarre ? Que représente-t-elle au juste pour ces êtres ? Nul ne le sait encore.
Etablie chez les Somalis et dans cette région, à peu près uniquement chez eux, les quelques Danakils, Gallas ou Yemenites qui la pratiquent aussi ne la pratiquant qu’au voisinage immédiat des Somalis, d’une manière irrégulière d’ailleurs, elle est ancrée fortement du golfe de Tadjourah au cap Gardafui, sur tout le désert sinistre qu’habite cette race et que limitent au Sud, à la hauteur environ d’Harrar, les premières assises des montagnes éthiopiennes.
Considérée comme très ancienne à la fois par les Européens, les Arabes et les Somalis, mais sans qu’aucun d’eux puisse fixer une date même approximative à son apparition, les Européens la croyant née d’une défense au moment des conquêtes musulmanes, les Arabes prétendant qu’elle existait avant leur venue en Afrique, les Somalis n’en sachant plus rien, il serait vain, aucun document ne pouvant nous y aider, d’en chercher historiquement l’origine.
Et force nous est, pour énoncer les plus valables de ses raisons d’être, de nous appuyer sur la base plus fragile de notre logique, de nos suppositions.
Parmi celles-ci, quelques-unes qui ont pourtant trouvé cours auprès de certains chercheurs doivent, il me semble, être écartées dès le début : raison d’hygiène d’abord. On ne peut raisonnablement, en effet, faire passer pour hygiénique une coutume qui, justement, tend à favoriser toutes les infections et maladies les plus graves et que les femmes refusent d’abandonner alors même qu’on les a convaincues de la nécessité réellement hygiénique d’y renoncer.
Raisons d’esthétique ensuite ou de mode, comparables, disent ces personnes, aux pieds mutilés des Chinoises. Mais outre qu’il n’est nullement prouvé que les Chinoises cèdent en cela à une manifestation esthétique, rien non plus n’explique par le truchement d’une mode l’opération Somalie.
On ne conçoit guère en effet une mode invisible, les femmes somalies répugnant à se mettre nues, à montrer leur sexe, même entre elles ou à leurs maris. On ne conçoit pas davantage qu’une mode aussi cruelle et dont elles ne retirent aucun avantage, ni extérieur, par la coquetterie, ni intime, par la jouissance, puisse durer des siècles, à supposer qu’elle ait existé un moment.
Raison de sexualité viciée, basée sur les faits absolument incontrôlés et probablement erronés, de goûts sodomiques chez l’homme et qu’il aurait déviés ainsi au profit de la reproduction, de la minceur fréquente de leur membre viril, de leurs capacités moyennes1 en matière amoureuse et qui nécessiteraient un adjuvant érotique de cet ordre.
1. Le Somali, au contraire, est assez sensuel. Abusant très jeune de l’amour, il s’en fatigue vite pourtant et vieillit prématurément.
Assertions faciles à détruire par l’objection que ce n’est justement pas l’homme qui tient à cette coutume, ni ne l’impose, par la certitude que l’homosexualité est chose rare, sinon inconnue, dans la brousse, bien que plus fréquente peut-être à Djibouti où les vices d’un grand port peuplé de diverses races créent évidemment des cas, mais, en ce qui concerne les Somalis, encore bien exceptionnels.
Ces différentes hypothèses écartées, examinons maintenant celles qui semblent les plus probables :
Mesure de protection qui aurait été employée pour soustraire les filles aux viols des tribus voisines, des envahisseurs yemenites surtout, très friands en effet de la beauté de ces filles, moyen efficace évidemment de détourner les ravisseurs en quelque sorte occasionnels et pressés, car l’obstacle comporte quelques difficultés à franchir, mais coutume moins explicable en cas de rapt, d’esclavage et qui, en fin de compte, n’empêche rien, ne peut que reculer la prise de possession.
Supposer une mesure de protection implique au moins son utilité. En admettant que cette coutume ait protégé et protège encore, en certaines parties du désert, la fille Somalie, comment expliquer que les femmes une fois ouvertes ne le soient qu’en partie, qu’étant accouchées, même si elles sont prostituées, on éprouve le besoin de ressouder leurs chairs, qu’on ferme aussi bien les petites filles destinées au métier de charmoutte que les autres, que le mari, lorsqu’il s’absente, ne referme pas entièrement sa femme, que cette coutume enfin ne décroisse pas là où la protection des Européens assure aux indigènes de n’avoir plus à craindre ni rapts, ni esclavage ?
Aucune lueur en faveur de la suppression de cette barbare coutume n’apparaît en effet dans l’étrange volonté de ces femmes, même des plus civilisées d’entre elles. Terrorisées au contraire à l’idée qu’on pourrait la leur interdire, que craignent-elles donc qui soit pire que leurs souffrances ?
Moyen d’intégrité virginale, disent d’autres observateurs. Assurance absolue que la fille n’a pas été touchée, garantie que prendraient les parents sur sa valeur marchande. Pour ma part, je suis beaucoup plus favorable à cette assertion qu’à la première, y trouvant une harmonie plus conforme à la vie de ces peuples nomades qui promènent à la fois leurs chameaux et leurs filles, interminablement, dans le désert, jusqu’au jour où ils se décident à en conclure quelque marché avantageux ; je me sens appuyée dans cette idée par l’idée même que les femmes se font de valoir davantage quand leur orifice est petit, plus semblable à celui de la vierge qu’elles furent et qu’on a payée très cher et par le fait qu’elles se font souvent refermer après répudiation ou veuvage, bénéficiant ainsi, grâce à cette fraude, d’une valeur nouvelle.
Dans cette race abominablement vénale, une coutume aussi barbare a très bien pu naître et peut se perpétuer encore, à la faveur du goût de l’argent. Cette supposition expliquerait mieux aussi que les femmes n’aiment pas être largement ouvertes et se fassent recoudre à chaque accouchement ; une petite reprise est moins visible et moins douloureuse qu’une grande s’il devient nécessaire de remettre tout en état.
Une chose cependant restera toujours en suspens, qu’on admette cette coutume comme une mesure de protection ou comme un moyen d’intégrité virginale : la question de l’excision du clitoris.
Or, nous le voyons, on n’infibule pas les petites filles somalies sans les exciser au préalable, et la double opération n’en fait en somme qu’une seule. Double précaution qui n’a de commun qu’un désir, semble-t-il, celui de supprimer non pas un attrait ou une facilité pour le ravisseur — l’homme ici ne s’occupe pas du plaisir de la femme et ne s’embarrasse guère des difficultés à vaincre ni des nécessités cruelles pour parvenir à son but — , mais la propension même de la femme à faire l’amour, sa tendance animale au rut.
La malédiction que les femmes jettent à toute sensualité, l’accusant d’être l’effet d’un mauvais sort, d’une possession, que des rites d’exorcisme peuvent seuls chasser ; cette fermeture à laquelle elles tiennent tant et qui paraît leur être une protection, non contre les hommes, mais contre un démon s’introduisant en elles par les voies génitales ; leur pudeur en matière sexuelle qui comporte mille simagrées, mille peurs, qui nécessite de fermer fenêtres et portes quand on veut les examiner, qui ne consent qu’à contre-coeur à certains débridements nécessaires quand elles sont malades, y préférant même parfois la mort1 ;
1. Au dispensaire a été observée une jeune fille atteinte d’un hématocolpos volumineux et qui a préféré s’en retourner mourir dans la brousse plutôt que de se laisser ouvrir.
cette tendance à toujours refermer ce qu’on a dû obligatoirement ouvrir, comme dans le cas de l’accouchement, sont indicatives d’une défense en quelque sorte rituelle, d’une castration volontaire exercée au nom de je ne sais quel culte sanguinaire et sexuel, d’un sadisme initial dont elles auraient maintenant perdu le sens exact. Sadisme, obligation de « couper » 2 sans cesse, amour du couteau qui ne préside pas seulement à leurs diverses opérations sexuelles, mais dont elles font le simulacre de se servir dans leurs cérémonies d’exorcisme, dont elles se tailladent les jambes et les bras quand elles ont la fièvre, assurant que le mal s’en va dès l’effusion du sang.
2. Couper en langage somali veut dire aussi tuer. Couper un animal est équivalent à tuer un animal.
Goût de la mutilation sexuelle, en corrélation étroite avec cette nécessité qu’elles imposent à l’homme et qui va jusqu’à ne pas permettre à un garçon de se marier s’il n’a pas émasculé un homme auparavant, serait-il même le plus fort, le plus puissant, le plus riche de sa tribu, même s’il est lâche : le meurtre d’un enfant, d’un vieillard, d’un homme endormi, l’éventration d’une femme enceinte dont on peut retirer un foetus mâle, comptant comme rite autant que la mise à mort d’un ennemi. Amour de l’attentat sexuel plus qu’exaltation du courage ou de la force. Comme on le voit en certaines tribus plus sauvages où se conservent mieux les anciens rites, dans le Cercle de Dikkil1 en particulier, où le trophée viril apporté par le meurtrier au chant du motif suivant :
Gomme un couteau bien affilé.
Grands Pères : nous aussi nous coupons bien.
C’est un grand homme que je donne aujourd’hui.
En pâture aux oiseaux2
1. Dikkil : agglomération constituant le centre d’un des trois cercles administratifs de la Colonie, à la jonction des tribus somalies et danakilh, située dans le sud de la Colonie.
2. Chant Issa, recueilli par le capitaine S., traduit par l’interprète du poste militaire.
est suspendu à un arbre, battu ensuite par les femmes et mangé, comme l’indique le refrain, par les oiseaux.
Le cadi de Djibouti, Ismaïl Chansan3, à qui je demandais un jour s’il connaissait les raisons qui faisaient agir ainsi les femmes somalies, m’a, peut-être mieux que tant d’autres informateurs, indiqué le véritable chemin à suivre pour résoudre cette énigme, quand de sa voix lente, fataliste, étonné d’ailleurs que je puisse attacher tant d’importance à ce que les femmes font ou ne font pas, m’a répondu : « Ne fais pas attention. C’est né dans leurs cerveaux sans raison… Elles sont folles ».
3. Arabe originaire du Yemen.
Folles, non pas, mais conservatrices peut-être d’un instinct de cruauté que leurs têtes, justement sans raison, tardant à se civiliser, n’ont pas encore refoulé.
Elles-mêmes l’indiquent lorsque, répondant à la même question que celle posée au Cadi et que je leur ai posée à elles-mêmes tant de fois, disent ce simple mot : C’est Marabout4, essayant par là de nous convaincre, comme elles en sont convaincues elles-mêmes, de l’impossibilité où elles sont d’échapper à quelque chose d’aussi grand.
4. Marabout veut dire saint, sanctifiant ou sanctifié, en même temps qu’il exprime un homme saint ou le tombeau d’un saint, par extension aussi parfois un lieu saint, un objet saint.
Djibouti, Janvier-Mai 1936.
Source : https://www.persee.fr/doc/jafr_0037-9166_1937_num_7_1_1619
Merci à Manat El Balbeur
Témoignage de Cizia Zyké (1986)
 Fils d’un légionnaire français d’origine albanaise et d’une mère grecque, Cizia Zykë passe son enfance à Taroudant dans le sud du Maroc. Sa famille s’installe à Bordeaux lorsque le Maroc gagne son indépendance en 1956. Après divers déboires avec la justice, il se met en tête, au début des années 70, de bâtir un empire en Afrique “en vendant des camions pourris à des hommes qui ne le sont pas moins” selon ses propres mots.
Fils d’un légionnaire français d’origine albanaise et d’une mère grecque, Cizia Zykë passe son enfance à Taroudant dans le sud du Maroc. Sa famille s’installe à Bordeaux lorsque le Maroc gagne son indépendance en 1956. Après divers déboires avec la justice, il se met en tête, au début des années 70, de bâtir un empire en Afrique “en vendant des camions pourris à des hommes qui ne le sont pas moins” selon ses propres mots.
Il en tirera un livre, SAHARA, publié une décennie plus tard, en 1986.
C’est un témoignage “brut de décoffrage” sur les réalités de l’Afrique et des Africains de cette époque, pas ausi lointaine que l’on pourrait vouloir le croire.
Le passage ci-dessous (pages 216 à 218) relate la manière dont il va dissuader ses graisseurs (les mécaniciens africains affectés individuellement à chaque camion du convoi) de s’intéresser de trop près à trois jeunes françaises, touristes “Peace and Love” dont la 2CV est tombée en panne en plein désert et qui ont été chargées, avec leur 2CV, dans un camion du convoi.
« Patron … »
Il y a des sourires, les graisseurs se dandinent et rigolent.
« Patron, les filles, c’est touristes ? »
En Afrique, c’est un truc nouveau, cette apparition de touristes. Ils connaissent le mot, le nom de cette nouvelle tribu, mais ça ne leur évoque rien. Comment leur expliquer ? Aller voir quelque chose de différent, se déplacer pour le plaisir, ce sont des notions trop compliquées pour les types d’ici. Ce sont des gens très simples. Ils ne connaissent que leur coin. C’est d’ailleurs pour ça qu’ils croient tout ce que je leur dis, et que j’en profite.
Ils se sont tous rapprochés, sourire aux lèvres. Les regards brillent. Chez les Noirs, on ne voit même que ça. Leurs grands yeux, et leurs dents.
« Ces filles-là, ça vaut rien. »
Ils attendent des explications, tous. La femme européenne, ils ne connaissent pas. Les leurs, soit elles sont voilées, soit on leur a coupé le clitoris pour qu’elles ne fassent pas chier. L’amour à l’européenne, ils ne connaissent pas. Ils tirent un coup, rapide, à sec, pour assurer la descendance et c’est à peu près tout. En plus, ils sont excessivement prudes.
Ce truc qu’elles ont entre les jambes, ils n’y touchent même pas. Ils ne veulent pas savoir à quoi ça ressemble. Alors, par gestes, j’explique.
« Ces filles-là … »
(…)
« Là, entre les jambes, vous savez ce qu’elles ont ? »
Non. Ils ne savent pas.
« Elles ont des dents dans le vagin. Dans le trou, des dents. »
Je montre des dents, l’endroit où ça se passe. « Si un homme essaie … »
Une main paume en l’air, et j’abats l’autre comme un couperet.
« Klak ! »
Jacky a embrayé sur le coup. Même geste de la main, et il crie :
« Klak ! »
Les graisseurs font tous un bond en arrière, terrifiés. Ils crient en dialecte, se protègent instinctivement, Jacky continue.
« Klak ! Klak ! »
Il s’avance, et les graisseurs reculent, épouvantés.
Capone embraie : « Oui les gars, un coup de ratiches et klak ! Plus rien ! »
Jacky : « Les dents sont pointues, c’est aiguisé, ça coupe d’un coup. Klak ! »
Capone : « Ces crocs qu’elles ont ! Klak ! »
Samuel Grapowitz est tout sourire dans son coin. Il est en train de regarder toute la concurrence qui disparaît, et compte se retrouver seul en lice pour séduire les filles.
Les hommes se calment. Les graisseurs discutent entre eux. Albana la ramène. Lui s’était fait discret ces derniers temps, il a retrouvé une occasion d’étaler sa science. Il s’est levé, il a pris l’air supérieur et, doctement, il déclare que j’ai raison. Il est allé en Europe, il a vu, et ce que j’ai dit est vrai. Ahmed le montre du doigt.
« Toi, Albana ? Klak ! Klak ?
— Non, je l’ai vu dans les films. Moi, en Europe, je suis allé au cinéma. J’ai vu des films. »
Et il embraie sur une tirade en arabe. Les autres écoutent sérieux, surtout les Tamacheks. Il doit leur parler de la religion, des femmes impures et tout ça.
Après cette mise en scène, je suis tranquille. Ils feront tout pour s’écarter des filles.
909 total views, 2 views today




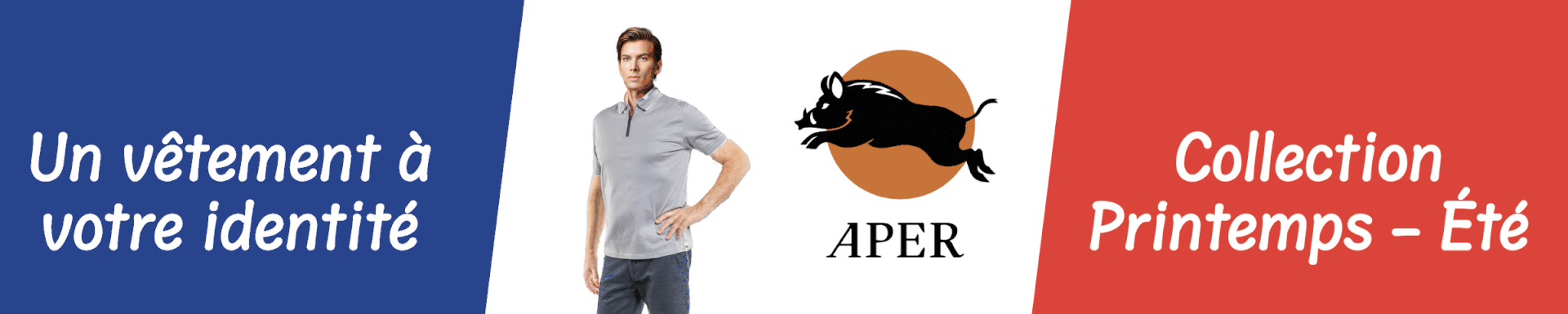
Vivement l’arrivée d’un vrai chef pour que les derniers citoyens dotés d’un cerveau en état de fonctionner descendent dans les rues pour faire le ” ménage” et répondre à l’imam de Lille: “le temps n’est pas encore venu de prendre les armes ”
Ce sac à merde sur pattes est en bonne place sur la liste des cafards…
GAVIVA…..
jusqu au bout de l horreur avec ce que vous avez ecrit…
la vache c est a gerber!!!!
@Caughnawaga j’ai assisté quand j’étais étudiante à l’évacuation d’un hématocolpos chez une jeune fille, plus d’un litre de sang menstruel pourrissait dans son utérus. La puanteur est indescriptible et pourtant j’en ai vu et senti dans ma vie! C’est le PIRE, pire que les escarres avec nécrose, pire que la gangrène pire que la MERDE et le vomi….
Il y a aussi les fistules, lorsque le vagin, le méat urinaire et le rectum communiquent parce que le tissu cicatriciel s’est déchiré lors qu’un accouchement. Ces gens sont répugnants, je n’ose pas dire primitifs parce que les Cro-Magnon et autres ne faisaient pas ça. Les animaux ne font pas ça. Eux si et plus encore.
C’est monstrueux, ignoble, barbare et surtout, inhumain.
Seule la mort de cette engeance pourra purifier cette région du monde…
J’ai lu que des femmes mouraient lors de leur nuit de noces après avoir été ouvertes, au bout de leur sang et que la plupart après un accouchement devenaient incontinentes autant des intestins que de la vessie. Et elles puent et leurs maris vont se chercher une nouvelle épouse.
C terrible que ça se passe encore au XXIème siècle. Comment voulez-vous que ces gens là puissent vivre dans des sociétés civilisées.??? Impensable, ils ne se posent aucune question, genre on a qu’à changer de traditions. Ils sont des primitifs, on ne peut rien faire.
@TEMPLIER, y’a pas de mal, et cette affreuse séquence en fait partie.
Dire que c’est toujours d’actualité c’est encore ça le pire. Y’a des gens incapables d’évoluer décidément
Templier@Je n’ai pas pu regarder la vidéo jusqu´au bout .C ´est vraiment horrible .Quelle barbarie .
Comment ne pas parler de sauvages ?…Bah, faut bien qu’ils s’occupent sur leur tas de caillasses.
On compte bien qu’après la PMA, nos députés français en marche et/ou couchés légiféreront pour faire prendre en charge ces pratiques par l’assurance santé pour les “réfugié-es” somaliens et apparentés qui en feraient la demande !…
Je crois que c’est déjà le cas pour la reconstruction
d’hymen, les circoncisions etc… !!… Que représentent ces dépenses ? = Mystère !
Allo MLP, en voilà une question qu’il serait intéressant de poser au Président de l’A.N. ! Ah non, trop clivant …Ah bon …
Une bonne nouvelle : le nombre d’enfants par femme n’était plus que de 5,7 en 2018 (il était de 7,80 en 2000!!..). Et pourtant, il faut découdre et recoudre à chaque fois la pachôle fan de chichourne ! Là on peut parler de besogneux, vingt dieux !
Comment peut-on forniquer autant dans des pays de sable et de caillasse où il n’y a rien à bouffer ? Encore une histoire de charia et de guerre des ventres ???….
Ah ils sont forts leurs marabouts !!…
Dans le document sur la violence domestique intitulé Guerre de basse intensité contre les femmes, l’auteure note qu’une phase de violence contre la femme est toujours suivie chez elle d’une période d’apathie. Cela pourrait expliquer l’apathie permanente décrite chez les somaliennes vivant un état de torture par mutilation génitale permanente.
Cizia ZYKE : à lire absolument les deux livres suivants : SAHARA et ORO. Ces sont les aventures fantastiques de ce baroudeur en Amérique du Sud et en Afrique.
C’est du brutal (comme dirait Audiard) qui sera peut-être plus apprécié par la gent masculine.
Un régal pour ceux qui aiment.
tenez regarder ca c est pas mal….désolé GAVIVA….
https://youtu.be/kn-4Od4PJ6c
les mains noires en haut sur la photo on dirai qu elles sont pleines de terre ou de sable pour aller trifouiller dans le clitos d une gamine avec une lame de rasoir la aussi on dirai….des malades mentaux ces gens!!!!
Il n’y a pas longtemps j’ai trouvé un ancien documentaire sur les rituels sexuels africains. Je ne mettrais pas le lien ici, c’est du porno on peut le dire.
Et vraiment dégeulasse. Entre les phallus en bois trempés dans le sang de poulet aux serpents vivants introduits dans le vagin à la copulation dans des trous creusés dans la terre. A vomir!
“Des questions se posent également à propos de la position d’Ilhan Omar (représentante musulmane d’origine somalienne du Minnesota au Congrès américain) à ce sujet parce qu’elle adhère manifestement à la charia, comme en témoigne son hijab, et les MGF (mutilations génitales féminines) sont obligatoires dans la loi islamique: «La circoncision est obligatoire (pour chaque homme et femme) (en coupant le morceau de peau sur le gland du pénis de l’homme, mais la circoncision de la femme se fait en découpant le bazr «clitoris» [cela s’appelle khufaadh «circoncision féminine»]). » – Umdat al-Salik e4.3, traduit par Mark Durie, Le troisième choix , p. 64
Pourquoi est-ce obligatoire? Parce que Muhammad aurait dit cela: «Le père d’Abu al-Malih ibn Usama raconte que le Prophète a dit: ‘La circoncision est une loi pour les hommes et une préservation de l’honneur pour les femmes.’» – Ahmad Ibn Hanbal 5:75
«Rapporté Umm Atiyyah al-Ansariyyah: Une femme pratiquait la circoncision à Médine. Le Prophète (que la paix soit sur lui) lui a dit: ‘Ne coupez pas sévèrement car c’est mieux pour une femme et plus désirable pour un mari.’ »- Abu Dawud 41: 5251
Ce hadith est classé comme faible, mais celui-ci est classé comme sahih (fiable): «Aishah a raconté:« Quand le circoncis rencontre le circoncis, alors en effet Ghusl est nécessaire. Moi et le Messager d’Allah avons fait cela, alors nous avons exécuté Ghusl. »- Jami` at-Tirmidhi 108
Si Muhammad avait mutilé les parties génitales de sa femme préférée, Aisha, c’est une forte approbation de la pratique de l’homme qui est un «excellent exemple» (Coran 33:21) pour les musulmans.
Pourquoi est-il important que les MGF soient islamiques ou non? Parce que la pratique ne sera jamais éradiquée si ses causes profondes ne sont pas confrontées. Tant que ces musulmans continueront à croire qu’Allah et Muhammad le veulent, pour certains cela l’emportera sur toutes les autres considérations.”
https://www.jihadwatch.org/2019/07/ilhan-omar-berates-muslim-questioner-for-asking-her-to-condemn-female-genital-mutilation
En juillet 2019, la représentante du Minnesota au Congrès américain d’origine somalienne Ilhan Omar réprimande le président de l’organisation Musulmans pour les valeurs progressives pour lui avoir demandé de condamner les mutilations génitales féminines. Cela ne lui aurait rien coûté d’affirmer son engagement à condamner cette pratique mais elle a choisit de ne surtout pas le faire et plutôt condamner avec emphase le représentant de cette organisation pour cette question mal venue selon elle. Ce que je trouve “habile” pour soigner son électorat somalien et musulman dans le pire sens. https://www.jihadwatch.org/2019/07/ilhan-omar-berates-muslim-questioner-for-asking-her-to-condemn-female-genital-mutilation
Traduction menu droit de la souris ou icône à droite sur la barre d’adresse.
Trump se demandait qui pouvait bien avoir voté pour Ilhan Omar, somalienne, comme représentante du Minnesota au Congrès américain étant donné ses déclarations de détestation des Etats-Unis, de la police. Raymond Ibrahim y répond dans un article chez FrontPageMag dans lequel il conclut que les somaliens qui ont voté pour elle par principe de loyauté hégémonique spécifiquement islamique alwala walbara ne comptent que pour 1% de la population et que tous les autres électeurs ayant voté pour elle sont des blancs lavés du cerveau par l’éducation gauchiste qui nimbent l’étranger d’une aura de perfection très éloignée de la réalité. Et ça c’est effrayant. https://www.frontpagemag.com/fpm/2020/09/scary-answer-trumps-question-ilhan-omar-raymond-ibrahim/ traduction menu droit de la souris ou icône à droite sur la barre d’adresse.
La carte mondiale des abus commis sur les femmes marque en aigu l’Afrique musulmane. Et selon moi même si ce sont les femmes somaliennes qui réalisent les excisions et infibulations, c’est l’organisation globale de leur société qui les y précipite et les y maintient. Symptôme d’une société malade mentale que l’islam entretient plutôt que n’éradique.
et la condition des fillettes en France ?
si on en parlait ??????????????
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/fillette-violee-dans-la-vienne-un-suspect-interpelle_4114279.html
a bord d’ une camionette volée, appartenant a une dame qui a été violée
viol ,vol, vielle, vieille…………
QUAND A LA CAMIONETTE ELLE EST INTACTE
a quand le rétablissement d’ urgence de la peine de mort ?
alors Clémentine Autin , une declaration ????
“Les femmes d’in Çalah, mangeuses de chats à l’occasion de la fête Es Sabaa,”
chez nous, on sait les mangeurs de chattes , au grand bonheur de ces dernières 😆
ce “journal de la société des africanistes” semble un bijou que je vais essayer de me procurer
dans ces contrées de grands progrès, je suis sur que c’est toujours pareil qu il y a 150 ans
Phrase typique des militaires abordés par les putes à Djibouti : “t’es cousue ou t’es coupée ?”
Juste après le café-croissant, merci Laurent P pour ce moment 🤮
Je sens que l’on va profiter d’ici peu de ces merveilleuses coutumes exotiques.
Et bien sûr Schiappa, Autain, De Haas et toutes les néoféministes débiles et “welcome refugees” pointeront l’archaïsme et la violence du patriarcat blanc occidental…